‘Tract Hebdo’ – www.tract.sn – Fondateur : Ousseynou Nar Gueye – Directeur de Publication : Damel Gueye – Éditeur : Axes et Cibles Com – E-mail : contact@axes-et-cibles.com. Pour payer votre abonnement semestriel (12.000 FCFA) ou annuel (20.000 FCFA) : un envoi Wave en allant à ce lien : https://pay.wave.com/m/M_sn_Hg6BHmG4BCxk/c/sn/ . Ou un envoi Orange Money au code marchand suivant : 598752. ‘Journal digital de gauche, avec une très bonne droite!‘
Tendances de l'Actu




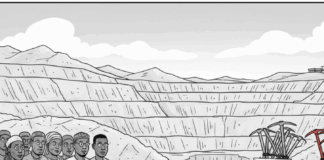


![[L’ET DIT TÔT D’O.N.G] COMDAMNER ‘L’APOLOGIE’ DE L’HOMOSEXUALITÉ ? LA LIBERTÉ D’EXPRESSION SACRIFIÉE SUR L’AUTEL DU POPULISME (Par Ousseynou Nar Gueye)](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/03/Ousseynou-Nar-Gueye-en-costume-marron-et-chemise-noire-12-mars-2026-324x160.jpg)


![[Éditorial] ‘Affaire Softcare’, la page tournée : la victoire de la transparence et du ‘Made in Senegal’ (Par Bassirou Niang, journaliste)](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/03/SOftcare-epilogue-transparence.png)
![[Bouli..Mimi..que] Coalition du PR : Mimi Touré déploie les tentacules, PR Diomaye rabaisse le rideau sur le Pastef ‘mimifié’ (Par Ousseynou Nar Gueye)](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/03/Ousseynou-Nar-Gueye-veste-jean-cravate-grise-gros-plan.jpg)
