Par Malick Diawara, Le Point – Avec « Ne reste pas à ta place », la réalisatrice, journaliste, chroniqueuse et activiste témoigne de son parcours atypique. Comment arriver là où personne ne vous attendait ? C’est autour de ce thème que Rokhaya Diallo a construit son livre témoignage mais aussi autobiographique* où le ton est donné par une citation de René Char : « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s’habitueront. »
Pourquoi ce livre ?
Rokhaya Diallo : C’est un livre que j’ai voulu faire parce que 2019 marque la 10e année de ma présence régulière dans les médias et de mon parcours de journaliste. J’ai trouvé que c’était un moment d’étape important pour raconter ces dix ans qui ne se sont pas du tout déroulés comme j’aurais pu imaginer et qui m’ont conduite à un métier auquel je ne me destinais pas initialement, et à une place à laquelle je ne m’attendais pas.
Il y a aussi que, quand je participe à des événements publics, je reçois beaucoup de questions de personnes qui me demandent tout simplement comment je fais pour affronter la haine que je reçois régulièrement, les oppositions dont mes discours font l’objet. Face à cela, je voulais très simplement partager quelques recettes personnelles.
Comment imaginiez-vous ce métier quand vous avez commencé ?
J’ai commencé ce métier sans avoir le sentiment de le commencer. J’ai été repérée sur un plateau de télévision comme chroniqueuse et pas comme journaliste. C’était temporaire. J’ai travaillé au départ à RTL et à Canal+, pour lesquelles j’avais signé pour une saison. Je ne pensais pas aller au-delà, car j’avais un autre métier. J’étais dans le dessin animé et dans la production. Pour moi, cette année-là était un peu une parenthèse pour surtout écrire un livre alors que mon ancien job ne me donnait pas forcément le temps. De fait, j’ai commencé le journalisme sans vraiment avoir de projection, car je ne m’imaginais pas un instant me professionnaliser dans cette voie. En somme, le journalisme m’est un peu tombé dessus.
Vous dites que vous avez suivi un parcours loin de ce que la sociologie prévoyait pour vous ? Pourquoi ? Parce que vous avez su saisir les opportunités ou par sens du défi ?
Je ne dirais pas qu’il y avait une volonté de ma part de défier la sociologie. En fait, j’ai grandi en n’ayant pas conscience de la sociologie. Quand j’étais petite, je regardais les séries où les femmes étaient médecins, avocates, professeures, etc. Je me suis identifiée à elles et au travail qu’elles exerçaient sans forcément me dire que je ne pouvais pas le faire parce que j’étais issue d’un milieu populaire, et parce mes parents étaient immigrés. Et cela, d’autant que mes parents m’ont encouragée en me disant que je pouvais tout faire. Cela a beaucoup compté pour la personne que je suis devenue et qui a finalement défié la sociologie. J’ai eu des opportunités qui se sont présentées à moi. J’en ai accepté certaines, j’en ai refusé d’autres. Et surtout, j’ai toujours cru dans ce que les gens voyaient en moi.
Souvent, les femmes ont des opportunités, mais, dans le doute, elles se disent qu’elles ne sont pas capables. On est en fait souvent conditionné à ne pas connaître forcément l’amplitude de nos capacités. Ma chance à moi, c’est que j’ai confiance. Vous me proposez quelque chose, je me dis que je peux le faire, et c’est ce qui m’a amenée à faire des choses complètement inattendues.
Que représente la France pour vous ?
La France est mon pays. C’est l’endroit où je me sens chez moi. Le français est ma langue, même si beaucoup de pays parlent le français sans être la France. Mon chez-moi en France se réduit particulièrement à Paris, qui est la ville où je suis née, la ville où j’ai grandi et où j’ai passé la majeure partie de ma vie. J’ai vécu en banlieue aussi et ai une conception de Paris assez étendue.
Cela dit, pour moi, la France, c’est la familiarité, c’est à la fois ce Paris qu’on peut traverser facilement, une ville dans laquelle on peut apprécier la gastronomie dans notre vie quotidienne, une ville avec cette capacité de révolte que je porte aussi en moi.
Ayant des origines étrangères, avez-vous un autre pays ?
Juridiquement, je n’ai pas d’autres pays, mais quand même. Je n’ai pas la nationalité sénégalaise contrairement à mes parents. Cela fait que je suis très attachée au Sénégal, même si c’est un pays dans lequel je n’ai jamais vécu si ce n’est pendant les périodes des vacances. Donc, oui, j’ai plusieurs pays.
Que représente l’Afrique pour vous ?
L’Afrique, c’est le continent dont sont originaires mes parents. C’est un foyer important de l’histoire de l’humanité, c’est un continent décrié dont je me sens vraiment partie prenante et très proche. C’est un continent que j’ai envie d’explorer. Pour l’instant, je connais surtout l’Afrique francophone, subsaharienne et du Nord. J’ai commencé à découvrir l’Afrique anglophone il y a peu et cela me donne vraiment envie de continuer. Cela dit, l’Afrique, je l’entends aussi comme le foyer des diasporas afrodescendantes, ce qui nous en rappelle aussi le destin assez cruel qui a été le sien. Cela me lie à beaucoup de personnes originaires du continent de manière plus ou moins lointaine et avec lesquelles je partage l’expérience d’être noire dans le monde.
Quel rapport avez-vous avec d’autres pays qui, comme la France, ont des minorités visibles ? Les États-Unis et la Grande-Bretagne, par exemple.
Les États-Unis sont un pays qui m’intéresse beaucoup et où j’ai eu l’occasion de me rendre plusieurs fois pour des raisons professionnelles, pour réaliser mes documentaires, dont trois sur quatre y ont été réalisés. C’est un pays qui a un passé esclavagiste et impérialiste, comme la France, mais qui, en même temps, est complètement différent parce qu’il a affronté sa question raciale de front, droit dans les yeux. Du coup, les combats des minorités américaines sont très visibles, contrairement à ceux des minorités françaises. Je trouve que, dans les théories qui ont été développées, il y a des choses intéressantes. De plus, des Français ont même inspiré les Américains, notamment des intellectuels américains antiracistes et féministes. Ainsi de Frantz Fanon et de Simone de Beauvoir.
J’entretiens aussi des rapports assez réguliers avec les États-Unis sur le plan professionnel. J’écris par exemple pour le Washington Post depuis l’année dernière. Cela dit, ce n’est pas un pays dans lequel j’aimerais vivre, même si j’aime bien y aller pour la bouffée d’air aussi bien intellectuelle qu’artistique que j’y trouve. Je suis très bien en France et mes séjours aux États-Unis me renforcent chaque fois dans la conviction qu’il faut que j’agisse en France.
Comment imaginez-vous un cadre législatif, politique, économique qui sanctionne toutes les discriminations, raciales, de genre, de mœurs et de religion, et renforce la devise de votre pays, la République française, à savoir « Liberté, égalité, fraternité » ?
Je pense qu’il faudrait vraiment mettre en œuvre le dispositif législatif qui existe. Les condamnations pour discrimination sont très rares aujourd’hui en France par rapport au nombre de plaintes et au regard du nombre de citoyens d’origine étrangère qui se sentent ou qui sont exposés au racisme au cours de leur vie. d’où le gros décalage qu’il y a entre leur ressenti et la manière dont sont perçues les sanctions que je trouve pas assez dissuasives parce que très, très faibles.
C’est un problème de textes ou d’application des textes ?
Je pense qu’il y a un problème dans l’application des textes, dans la reconnaissance des dommages et, en dehors du cadre légal, dans les sanctions sociales. On a ainsi des personnalités publiques qui tiennent régulièrement des propos racistes sanctionnés par la justice mais dont la reconnaissance du propos raciste n’a aucun effet social. Normalement, ce devrait être honteux et, a priori, les gens ne devraient pas avoir envie de s’associer à des personnes reconnues comme étant auteures de propos racistes. Et pourtant, beaucoup d’entre eux continuent à être reconnus et ne font pas l’objet d’une opposition majeure. Pour moi, cela signifie qu’il y a une forme de tolérance sociale pour le racisme qui est trop importante. La loi, c’est important, mais la capacité de réaction de la société signifiant aux personnes racistes que leurs propos ne sont pas acceptables me paraît très, très faible en France et dans beaucoup de pays européens.
Que peut-on faire pour le cadre politique ?
La volonté politique est nécessaire. Aujourd’hui, il y a une secrétaire d’État en charge du droit des femmes et de la lutte contre les discriminations. Elle n’est malheureusement pas souvent sollicitée sur les questions de discrimination. Je trouve que les politiques ne s’expriment pas assez suffisamment sur ces questions.
D’ailleurs, après le rapport du Défenseur des droits début septembre sur la discrimination, notamment à l’embauche, on n’a pas vu une déclaration, une décision politique qui indique qu’il faudrait mettre en œuvre ou promouvoir l’embauche des personnes qui sont exposées au racisme. Donc la question demeure difficile. En même temps, le fait qu’il y ait une législation européenne oblige des pays comme la France à se positionner. Par exemple, la création de la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité), qui est devenue le Défenseur des droits, a été rendue obligatoire par l’Union européenne à travers une de ses directives. On voit là qu’il est important d’avoir des instances supranationales comme les Nations unies et la Cour européenne des droits de l’homme, par exemple, qui peuvent interpeller la France quand elle ne répond pas à ses obligations ou n’est pas en adhésion avec ses propres principes.
On vous prête les propos selon lesquels il y aurait un racisme d’État en France . Que répondez-vous à cela ?
Pour commencer, ces propos ne sont pas de moi. D’autres en ont parlé avant moi : des philosophes reconnus et très en vue. Il y a aussi un syndicat d’enseignants qui avait parlé de racisme d’État. Ce que moi-même j’avais défendu. Quand on parle de racisme d’État, cela signifie que l’État produit du racisme. Et il en produit parce que ses structures le permettent. On ne peut pas vivre dans une république dont les fondements sont liés à une période coloniale sans imaginer que cette république continue de perpétuer cet héritage. C’est évident.
Cela dit, j’ai des cas très concrets de racisme d’État. Je pense que les chiffres du contrôle au faciès du fait de la police en sont une illustration. Quand on est un jeune originaire du Maghreb, d’Afrique ou des dom-tom, on a vingt fois plus de risques de se faire contrôler que le reste de la population. Le gouvernement ne fait rien contre cela, alors que c’est une institution de la République qui est impliquée. Donc c’est au moins du racisme par manque d’action.
D’autres exemples comme la manière assez spectaculairement inégalitaire dont les outre-mer sont traités donnent à réfléchir. Quand on pense aux essais nucléaires en Polynésie, aux conséquences aussi bien tectoniques qu’en termes de cancer sur les habitants, on voit bien qu’il y a un problème. Je pense aux problèmes écologiques et d’ordre environnemental dans les outre-mer qui sont vraiment liés à l’utilisation de produits qu’on n’utilise pas dans l’Hexagone. Je pense au chlordécone, qui fait que la Martinique et la Guadeloupe, de toutes petites îles, sont les territoires où les taux de cancer de la prostate sont les plus élevés au monde. Ce n’est pas le cas du reste de la France. De quoi s’interroger encore. Sinon, Françoise Vergès parle très bien du cas de La Réunion avec la stérilisation des femmes dans les années 70, les placements de force d’enfants dans des familles hexagonales. Tout cela, pour moi, est l’expression d’un racisme propagé par l’État français.
Finalement, en décolonisant l’Afrique dans les années 60, la France aurait donc dû se décoloniser l’esprit en même temps ?
La France a maintenu des liens très forts avec ses anciennes colonies. Elle leur a imposé une monnaie qui a été renommée à partir de son nom de l’époque coloniale (CFA pour Colonies françaises d’Afrique et devenues CFA pour Communauté financière d’Afrique). Beaucoup de ces pays devenus indépendants ont vu à leur tête des présidents placés par la France. Il y a aussi la présence de l’armée française sur des territoires souverains. Cela interroge sur la nature des liens. Je pense donc que la France n’a pas fait le deuil de la colonisation et qu’aujourd’hui il y a un continuum colonial non seulement sur le continent africain, mais aussi sur les territoires ultramarins et sur le territoire hexagonal, où on peut aussi parfois parler de gestion coloniale des territoires urbains comme les banlieues. L’usage de la force publique n’y est pas le même que celui qu’on peut voir ailleurs.
Pour vous, il aurait fallu une action publique très forte pour décoloniser les esprits ?
Déjà, il aurait fallu un travail d’éducation. Il y a un vrai travail de transmission à faire sur l’histoire de la décolonisation. Il s’agit de faire comprendre ce qui s’est joué à l’époque en termes de prise de pouvoir, en termes de lavage de cerveaux aussi des jeunes élites, du nombre de morts, etc. En France, on aime souvent parler du rôle positif de la colonisation. On parle d’une abolition de l’esclavage qui aurait eu lieu en 1848, mais on ne pense pas aux travaux forcés qui ont eu lieu sur les territoires coloniaux où des gens ont construit des chemins de fer, des routes parfois au prix de leur vie… C’était au XXe siècle et ce n’est pas si vieux que ça. Il y a aujourd’hui des personnes qui sont en vie, qui l’ont vécu et qui ont pu témoigner de cela. Tout cet héritage-là n’est pas présent dans la fiction, dans la littérature, et n’est pas suffisamment présent dans les livres d’histoire et dans les discours politiques. Je pense qu’on ne peut pas dire à des jeunes issus de cette histoire-là d’avancer dignement s’ils n’ont pas un ancrage, une reconnaissance de la souffrance passée, tout simplement.
Revenons à votre expérience personnelle. Comment comptez-vous faire adhérer des jeunes à votre démarche de « ne pas rester à sa place » ?
Je dois d’abord dire que ce livre que je publie et intitulé à dessein Ne reste pas à ta place n’est pas un livre de gourou (rires). Je ne vais pas commencer à lancer une secte. En fait, j’ai grandi avec une télévision vraiment monochrome et les seuls visages qui me ressemblaient venaient des fictions américaines. Et, quand ce n’étaient pas des fictions américaines, c’étaient des publicités ou des fictions où les Noirs étaient tournés en ridicule. Dorothée, par exemple, qui était une star des années 90, cuisinait dans un chaudron géant. Sur un autre registre, il y avait aussi un biscuit baptisé Bamboula. Tout ça pour dire que ce n’étaient pas des images très valorisantes. Du coup, ce que j’ai envie de dire aux jeunes qui m’aperçoivent sur un écran de télévision, c’est simplement que c’est possible même si c’est difficile. Et que, s’ils n’y arrivent pas, ce n’est pas de leur faute car on est dans un environnement qui rend les choses difficiles.
Je n’ai pas envie de chanter le mythe de la méritocratie parce que j’ai réussi à m’extirper d’une situation qui n’était pas forcément évidente au départ. Car en fait, j’ai fait de bonnes rencontres, et en tant que jeune, je n’ai pas eu peur d’avoir foi en moi tout simplement. J’ai vraiment envie de transmettre aux jeunes générations les outils qui m’ont permis de m’élever socialement, tout en leur disant qu’il faut tenir bon dans la mesure du possible, tirer les enseignements de chaque échec et tirer aussi des ressources de leur environnement culturel, parce que c’est important.
Y a-t-il donc lieu d’aider les jeunes issus de l’immigration à mieux connaître la culture de leurs parents, de leurs grands-parents ?
Je pense que c’est un choix qui est personnel. En ce qui me concerne, cela a été structurant. La culture de mes parents, sénégalais et musulmans, m’a donné un cadre de référence que j’ai mélangé avec ma culture française. C’est un cadre auquel je me réfère toujours maintenant. Par exemple, sur la question des femmes, du corps des femmes, j’ai tiré beaucoup d’inspiration de la culture sénégalaise. En France, les femmes qui vieillissent sont souvent déconsidérées, alors qu’au Sénégal le fait d’être une femme d’un certain âge engendre du respect et confère un statut social. En France, par exemple, on traitera quelqu’un de « sale vieux », alors qu’au Sénégal cela n’a aucun sens pour des raisons liées au respect accordé aux aînés. Cela m’a permis d’aborder la question de l’âge avec un autre prisme. Donc, même si sa culture d’origine est considérée comme mineure, ce qu’elle n’est pas en réalité, il y a des choses à prendre et à apprendre pour tenir bon. Il en est ainsi en ce qui concerne les canons de beauté de cette femme éternellement jeune et mince. J’ai ainsi passé ma vie avec une mère qui s’est toujours trouvée trop mince. Du coup, je ne suis pas vraiment sensible aux canons de mannequins toutes maigrichonnes qu’on nous présente comme étant les plus belles femmes du monde.
Donc, finalement, si vous deviez vous définir aujourd’hui, que diriez-vous ?
(Rires.) Je dirais que je suis Rokhaya Diallo, une Parisienne aux ascendances multiples, fière de tout ce qu’elle porte.
* Rokhaya Diallo, « Ne reste pas à ta place », Marabout 2019 – Sortie le 27 mars
Bonnes feuilles de « Ne reste pas à ta place » :
Si on ne sait de moi que ce que les raccourcis caricaturaux colportent, j’aimerais raconter pourquoi et comment je n’ai rien fait de ce que la sociologie prévoyait que je ferais.
Je viens de célébrer mes quarante ans et cela fait maintenant dix ans que j’interviens dans le débat public français. Le passage de ces dates symboliques appelle une envie : celle de me raconter, d’apporter un éclairage nouveau sur cette histoire unique qui est la mienne. Mon parcours est atypique. Journaliste, autrice, réalisatrice, je voyage à travers le monde pour y donner des conférences. Ce travail m’a conduite à être, en 2017, la seule Française invitée pour participer à l’inauguration de la Fondation Obama à Chicago. Il y a quelques années, si l’on m’avait conté ce parcours, je n’y aurais jamais cru ! Née et ayant grandi à Paris de parents ouvriers immigrés du Sénégal, rien ne me destinait à la vie qui est la mienne aujourd’hui. Pourtant, au fil du temps, j’ai constaté que j’avais de manière inconsciente établi mes propres règles. J’ai la conviction d’avoir puisé dans mon parcours des clés qui m’ont permis d’ouvrir les portes et de me trouver aujourd’hui à un endroit où l’on ne m’attendait pas. Et je pense que mon environnement immédiat et mes expériences familiales ont forgé la plupart de mes atouts. Je crois que ma vie d’aujourd’hui résulte des apprentissages liés à mon contexte social d’origine. En dix ans de vie publique, j’ai été témoin des évolutions majeures de notre société et actrice de bien des mouvements. Mon expérience m’a conduite à prendre part à la vie médiatique et politique de mon pays et à intervenir auprès d’institutions nationales et internationales. Mon point de vue et ma perspective, inhabituels dans ces milieux, m’ont offert un poste d’observation de choix.
En dix ans, ma vie a été littéralement bouleversée : de cadre dans une société de production, je suis devenue un personnage public dont le nom, associé à des idées parfois caricaturales, peut provoquer le plus vif rejet comme l’enthousiasme le plus surprenant. J’ai subi des épreuves qui m’ont permis de mieux me connaître. J’ai franchi des obstacles qui m’ont rendue courageuse. Paradoxalement, le tumulte parfois intense m’a apaisée. Il m’a permis de savoir mieux que personne qui je suis. Il m’a ancrée dans mon être et dans mon époque. Il m’a offert l’aisance nécessaire pour me mouvoir dans ce monde complexe, ce que je considère comme un immense privilège. Je ne suis pas à la place à laquelle ma naissance aurait dû me conduire. Pourtant je me sens plus que jamais à ma place.




![[LE BIAIS DE NÉNÉ SOW] Humilité, lucidité et une pincée du piment ‘Mimi Touré’ : les ingrédients de Diomaye, concepts non-enseignés dans les écoles du Pastef](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/03/Diomaye-cuisinier-et-Sonko-fache-218x150.png)
![[Très NRV] ‘Je dénonce la cherté du pagne officiel du 8 mars 2026 au Cameroun’ (Adeline Tsopgni, leader estudiantine)](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/03/Chantal-Biya-Defile-8-mars-2026-218x150.webp)

![[L’ET DIT TÔT D’O.N.G] 1er Sommet Afrique -France anglophone à Naïrobi : voici pourquoi ‘l’AFrance’ ne ‘garantira’ plus le Franc CFA en 2027 (Par Ousseynou Nar Gueye)](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260303-WA0003-218x150.jpg)
![[L’ET DIT TÔT HEBDO] Lois anti-homosexualité bientôt ‘durcies’ : le gouvernement Sonko 2 se trompe de cible et de siècle](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/02/Capture-decran-2026-02-27-165238-218x150.png)
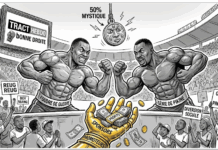
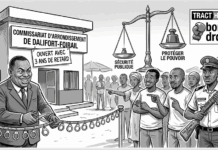
![[Triomphe de l’économie informelle] Kaolack en sueur, entre Ramadan, Koor, Carême et chaleur de 42 degrés à l’ombre](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/02/Capture-decran-2026-02-27-162111-218x150.png)


