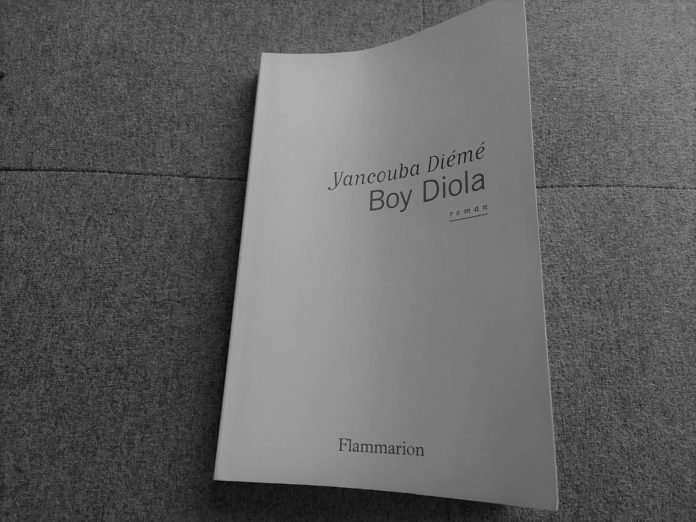Boy Diola est un des romans remarqués de cette rentrée littéraire en France. Ecrit par Yancouba Diémé, il relate la trajectoire d’un immigré, de son village casamançais jusqu’à son arrivée en France en passant par Dakar. Il éclaire d’un jour nouveau les migrations, en pleine période de crispation. Note de lecture d’un livre réussi. Un auteur à suivre.
« Ils se souviendront du Boy Diola qui dormait sur le capot des voitures, frappé par la chaleur du soleil. » Cela sonne comme une devise en page 148, celle de suivre le héros d’un livre remarquable. Boy Diola est l’un des romans les plus rafraîchissants de la rentrée littéraire française. Œuvre d’un jeune français d’origine sénégalaise et publiée par Flammarion, c’est un livre limpide et rempli de tendresse qui revient sur la trajectoire de Apéraw, son héros. Pour les familiers de la langue diola Apéraw n’est pas un secret : le mot désigne la joyeuse déformation en français-diola du père, très utilisé pour parler des papas. De Kagnarou, grand village, aux abords de Bignona, à Roissy en passant par Dakar, c’est le roman d’un binôme, celui d’un fils à l’ombre de son père, qui raconte son histoire : une vie de labeur et de douleur, forgée par un sens aigu de la débrouille, de l’ambition et de la détermination. Roman souvenir, roman histoire, roman à deux voix, roman social, roman de la migration, roman d’entre-plusieurs-eaux, Boy Diola est un livre qui imprègne la mémoire de sentiments doux-amers sans que l’équilibre littéraire ne soit jamais faussé. Par la précision des descriptions épurées et la compilation drolatique des anecdotes, le roman raconte la Casamance, Dakar, la banlieue, la vie d’usine et celle d’une famille nombreuse en banlieue française. Sans jamais tomber ni dans le voyeurisme, ni dans le misérabilisme. Il rajoute à sa panoplie une autre vertu : celle de susciter l’identification. Le décor et les lexiques, qui puisent abondamment dans la langue diola, replongent le lecteur – pour peu qu’il connaisse un peu la région ou la langue – dans un souvenir complice.
Le livre commence par une un épisode récent : l’auteur, né en 90, raconte l’arrivée d’une embarcation de migrants à Bonifacio en Corse. « On est en janvier 2010, il fait froid ce soir. Les vagues s’entrechoquent sur les petits cailloux. Les herbiers de posidonies sont à peine visibles. Un bateau approche à une heure habituelle. Il vacille dans le cahotement des vagues » (P9). Dès l’entame, une poésie, économe en emphase, habite le texte. Une écriture courte, dynamique, imagée, donne aux pages une entrainante clarté. L’arrivée de ce bateau n’est qu’un prétexte pour établir le parallèle avec l’arrivée du père, près de 40 ans plutôt en 1969 : « Au départ du bateau, au port de Dakar, des hommes ont voulu faire demi-tour quand ils ont vu la gueule de l’océan s’entre-ouvrir » (P153). Le décor est planté. Dans ce roman à la chronologie escarpée, les périodes narrées se suivent de manière discontinue. A partir de là, de ces deux arrivées de bateaux, on suit Aperaw et sa vie riche en soubresauts, que narre un fils attendri et d’autant plus renseigné qu’il est au premier rang de cette saga familiale.
Le premier tiers du roman parle ainsi de Kagnarou, « qui n’a rien à envier au sublime Thionck Essyl, chef-lieu de la région du Blouf » (p20). Petit village à côté de Bignona où le père fait un pèlerinage retour au début des années 2000, pour faire connaître sa terre d’origine à ses fils. C’est l’occasion de replonger dans les décors familiers de la Casamance, leur sens de l’accueil, avec pléthore de mots diola. On pense ainsi aux refrains récurrents dans les livres de Fatou Diome, mais aussi aux effets présents dans le livre Frères d’âme de David Diop. A Kagnarou, les mots dépeignent une vraie réalité. Les Kounifaanaw, vieux sages, le kadiandou outil agricole, le kumpo et le kankourang, attractions sociales, le Yooo qui ponctue les prières comme un amen local… Porté par une farce jamais trop appuyée, le livre glisse sur les anecdotes avec un humour calibré, tantôt dans la bouche du narrateur, tantôt dans celle du père : « Le diola il connaît pas les médicaments. Nous on connaît les racines, c’est tout. C’est ça notre médicament » (P21). Un sentiment habite le lecteur le long de ces petits chapitres digestes, sans fioritures : c’est l’art du récit de l’auteur. La limpidité de l’écriture fait de ces pages des objets volants qui se détachent quasiment tous seuls, pour ouvrir sur d’autres, aussi légères. De ce séjour, nul enseignement politique, nulle charge, la description et une certaine mélancolie font juste apparaître le contrecoup habituel de l’immigration : le détachement progressif, le sentiment de ne plus faire corps avec son pays. Sentiment éprouvé par l’enfant né à Villepinte, mais aussi par le Apéraw. Yancouba Diémé ne se pique pas de digressions politiques, ni même de discours autrement moraux. Il a opté à travers la légèreté, devant la gravité qui sourd parfois, à ne pas polluer son texte outre mesure.
 La suite du récit se passe en Île-de-France. Apéraw travaille dans l’industrie. Il y gagne raisonnablement sa vie. Il épouse une femme et la fait venir dans le cadre du regroupement familial en 1974. Ils auront beaucoup d’enfants. Il en épouse une deuxième. Là aussi, le roman glisse sur le sujet de la polygamie. Le récit est rapide. Il survole. Point de halte dans la pagaille sociétale, non plus dans l’équilibre familial, que l’auteur dépeint presque idyllique malgré les galères. Apéraw achète à crédit une maison, nourrit une ambition modeste et têtue. La famille vit bien jusqu’au drame premier qui prend la forme d’un coup de fil assassin, la mort de la mère du narrateur, Iña. Absente du récit en proportion inverse au père, « Améraw » est comme le personnage sacrifié du roman dont on ne sait pas grand-chose, à part son statut de femme de ménage à Roissy et son cancer qui l’arrache à la vie à 42 ans. Vie qu’elle quitte avec cette prophétie « quand je vais mourir vous allez pas m’oublier » (p64). A cette funeste nouvelle, s’ajoute le début des ennuis : « Le sort se déchaîne. Pendant l’absence d’Apéraw, trois mois au total, la banque, les huissiers, le juge, prononcent un avis d’expulsion. Sans pitié » (p65) Apéraw perd son emploi, vivote. Cet itinéraire du système-débrouille, de l’inventivité à l’affût des opportunités, font d’Apéraw un héros attachant.
La suite du récit se passe en Île-de-France. Apéraw travaille dans l’industrie. Il y gagne raisonnablement sa vie. Il épouse une femme et la fait venir dans le cadre du regroupement familial en 1974. Ils auront beaucoup d’enfants. Il en épouse une deuxième. Là aussi, le roman glisse sur le sujet de la polygamie. Le récit est rapide. Il survole. Point de halte dans la pagaille sociétale, non plus dans l’équilibre familial, que l’auteur dépeint presque idyllique malgré les galères. Apéraw achète à crédit une maison, nourrit une ambition modeste et têtue. La famille vit bien jusqu’au drame premier qui prend la forme d’un coup de fil assassin, la mort de la mère du narrateur, Iña. Absente du récit en proportion inverse au père, « Améraw » est comme le personnage sacrifié du roman dont on ne sait pas grand-chose, à part son statut de femme de ménage à Roissy et son cancer qui l’arrache à la vie à 42 ans. Vie qu’elle quitte avec cette prophétie « quand je vais mourir vous allez pas m’oublier » (p64). A cette funeste nouvelle, s’ajoute le début des ennuis : « Le sort se déchaîne. Pendant l’absence d’Apéraw, trois mois au total, la banque, les huissiers, le juge, prononcent un avis d’expulsion. Sans pitié » (p65) Apéraw perd son emploi, vivote. Cet itinéraire du système-débrouille, de l’inventivité à l’affût des opportunités, font d’Apéraw un héros attachant.
Le dernier tiers du roman évoque, dans un savant flash-back, la vie antérieure d’Apéraw à Bignona comme menuisier, à Dakar comme mécanicien, avant sa quête d’Europe. Cette vie dans la capitale suit la trajectoire commune des migrations d’abord intérieures. Du village, à la petite ville proche, ensuite à la grande métropole, avant le départ. Dakar est déjà un autre monde, grand et frénétique où « les pots d’échappement crachent leurs fumées noires. Au milieu du trafic perturbé et dans les gares, des estropiés rampent sr le sable rouge et viennent quémander » (P113). Apéraw y arrive en 1964. S’en suit une série de péripéties qui mettent en selle un personnage au flair virtuose qui vit chez des amis, des frères, des connaissances. Apéraw qui a connu la vie asoninké[i], avant la pénétration de l’islam « Du temps de avant-avant, les diolas étaient asoninkés, ni musulmans ni chrétiens. Le mot asoninké était un sobriquet donné par les mandingues qui se moquaient des fétichistes, ces grands consommateurs de vin de palme » (P30). Son fils résume « musulman en surface mais asoninké en profondeur. Emitèye, mon frère » (P32). De ce récit qui monte, d’étage en étage, on ne manque pas de penser à ce que Ousmane Sembène cinéaste aurait pu faire de ce roman, tant Apéraw partage avec le fils de la Casamance cette aptitude d’autodidacte. La souffrance du corps du père et la fragilité de sa condition à la merci des licenciements, occupe une bonne partie du texte et fait penser au livre d’Edouard Louis Qui a tué mon père, sans la virulente charge politique de l’écrivain bourdieusien.
Cœur du récit, avec les tractations avant le départ pour l’aventure européenne, cette partie du texte est plus vive, plus prenante. Le style au présent de l’indicatif dynamise le rythme et donne aux évènements du passé une tonalité actuelle. Plus dense, plus touffu, l’emploi du ton familier imprime au texte sa dimension complice et filiale. L’amour, la tendresse, l’admiration du garçon pour son père transpercent les pages, délicatement.
On peut déjà anticiper les reproches qui seront faits à ce livre, ils ne seront pas tous faux. On ne peut s’empêcher de penser que le roman coche toutes les cases du feel good, c’est un récit parfois simpliste, qui esquive tous les écueils sans jamais s’y frotter. Le style parfois journalistique ne s’épaissit pas, ce qui est dommage car on entrevoit chez l’auteur des aptitudes à l’analyse et à la beauté stylistique. Ça reste souvent très commun, sans virtuosité sur la longueur. La présentation des faits présente ce trait commun à beaucoup de romans de la migration : la description idéalisée de la terre virginale, et parfois une tentation exotisante. Le parler petit-nègre du père, ses réflexes abrupts, parfois volontairement naïfs ne manqueront pas de susciter un certain scepticisme. Cependant le réel dans le lequel se forge le texte anéantit toute critique d’invraisemblance. Ce roman vrai, biographique, dit les destins des premières générations de la migration dans leur fragile dénuement et dans leur admirable force et résilience. Le rêve d’Apéraw, malgré toutes ces péripéties, c’est l’Afrique. Cet ancrage, ce lien permanent, maintient le récit dans ce fil commun de l’ailleurs et de l’ici, définitivement liés.
En 16 chapitres courts, Yancouba Diémé, diplômé de création littéraire de la bouillonnante Université Paris 8, donne la mesure d’un talent certain. Par la force du témoignage, son abord du réel s’intègre parfaitement dans une narration poétique. Être le biographe du père, lui redonner un visage et sa vraie dimension, alors que les querelles sur la migration tendent à réduire ces vies à des chiffres, voilà l’exploit du jeune auteur. Au nom du père et du fils, le roman des Diémé est un roman universel, un roman de la gratitude et de l’amour.
« Quand tu vieillis
Ce que tu manges c’est pour toi
Le reste pour tes enfants »
Boy Diola, Yancouba Diémé, Flammarion, 2019, 17 euros.
[i] Vie païenne, animiste