Tract – Il est sorti en librairie ce jeudi 02 mars en France. Et il sera chez tous les bons libraires du Sénégal pour le 15 mars. « Les bons ressentiments, essai sur le malaise post-colonial » (Paris, Riveneuve, 2023, 219 p.) est un livre qui se peut se commencer, quelle que soit la page où on l’ouvre. Le « dernier Elgas », où foisonnent les noms propres, aurait gagné à avoir un lexique de tous ces patronymes, à la fin, avec renvoi aux pages où les acteurs de ce bestiaire africain tout-monde sont évoqués.
Pour paraphraser la boutade qui dit que certains « sont pessimistes dans la pensée et optimistes par l’action », Elgas est crépusculaire dans les jugements et solaire dans la démonstration. Il se sait redevable de ses différentes racines, mais il voit bien que ce qui sont les pieds de l’arbre qu’il est, ne plongent pas dans les mêmes humus. Mais elles y sont pourtant en même temps, toutes à la fois. Certaines débordent d’un pot de fleurs d’appartement parisien, d’autres nous ramènent aussi loin que le village casamançais de Coubanao, sorte de ‘‘Niafoulène-Les-Bains » dont même nous Sénégalais ignorons l’exacte localisation, d’autres au lieu d’enfouissement de son ombilic de naissance à Ndar, Saint-Louis, la ville des Signares, celles qui ont inventé le sado-masochisme avant la lettre.
Lorsqu’il a publié son premier ouvrage, « Un Dieu et des Mœurs, carnet de voyage», qualifié en couverture de récit, mais dans lequel il y avait aussi bien de l’autofiction que de l’essai , j’avais prié à voix haute et écrit pour souhaiter que le futur docteur en sociologie qu’il devait devenir l’année suivante n’enterre pas le volcanique et coruscant écrivain qu’il fut dès ce premier livre, en amoureux fou de la belle langue et amateur de la décomplexification de la pensée complexe, qui sont ses marque de fabrique. Il ne m’a pas écouté et il a bien fait.
Depuis son entrée en littérature officielle, toute de fulgurances, avec « Un Dieu et des Mœurs), Elgas a publié un roman (son premier, par acception tacite et explicite -ce dont je ne suis pas d’accord ), « Mâle Noir » ; une biographie, « Fadilou Diop, un juste » ; un recueil de chroniques dont je m’honore d’avoir participé à la parturition, ce qu’Elgas me reconnait avec gentillesse : « Inventaire des idoles – Le Sénégal de profil » . Tout cela au nom de la liberté. Liberté qui fait qu’il n’est même pas plus que ça fidèle à un éditeur. Alors que nos littérateurs basanés (ou caucasiens d’ailleurs !) font carrière chez le même éditeur pendant dix ans avant de seulement songer à aller voir si l’herbe a une encre plus verte ailleurs, depuis 2015, Elgas a ainsi successivement publié chez Présence Africaine, chez Éditions Vives Voix, chez Ovadia de Nice, puis dans une co-édition de ce dernier avec les éditions Sedar, et maintenant chez Riveneuve. Tout cela renseigne à souhait que la liberté chez Elgas n’est pas une posture. Mais une urgence irrépressible de son être au monde. Il le sait, avec la lucidité qui n’est jamais loin de l’aveuglante lumière qui fit qu’Icare se brûla les ailes et les yeux de s’être trop approché du soleil céleste, et il en rend compte en page 217 de ce présent ouvrage, dans « Perspective Personnelle ». Si l’auteur satiriste Pierre Desproges, qu’Elgas révère, a pu dire que « l’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne » ; mon propre paternel menaçait les membres de ma fratrie d’un : « tu veux être libre ? le chemin de perdition est devant toi ! Mais je ne te laisserai pas y aller, sans passer par mon corps ! ».
En octobre 2022, j’avais omis de commettre une note de lecture pour le recueil de chroniques tout juste publié, « Inventaire des Idoles – le Sénégal de Profil » : sans doute me croyais-je exonéré de cela par un totem d’immunité, ayant écrit la postface du recueil en question. Mon site d’info Tract.sn avait donc juste publié dans ses colonnes la recension de l’ouvrage faite par un journaliste, qui n’était même pas de notre rédaction ! Mea culpa. Ce dernier Elgas donc, je tenais ardemment à le recenser. `
Cet essai d’Elgas, « Les bons ressentiments – essai sur le malaise post-colonial », est un « must-read » (voilà que je m’échappe de la langue française, oups !). Cet essai est le pendant sociologique du conte philosophique où l’enfant dans la foule d’adultes, voyant le monarque prétendument habillé des atours les plus beaux que son tailleur s’est évertué à lui trouver et qui se pavane dans la foule éberluée dans ce qui n’est autre que sa tenue d’Adam, s’écrie : « Mais, le roi est nu ! ». Il est dur d’être le premier à dire « le roi est nu », mais on peut vite faire école avec, une fois les yeux de la plèbe d’adultes dessillés.
Nos rois, nos idoles de la prose, de la poésie et de l’imprécation sociologisante anti-néo-coloniale, désormais dite décoloniale, mode dictatoriale de nos tristes temps, sont nus. Parce que quand ils sont contre l’ennemi tout désigné, l’Occident au sens large, la France pour faire court, ils sont « tout contre ». C’est-à-dire arrimés à elles et bien au chaud, vivant des prébendes et subventions de sa politique d’« exception culturelle », de sa validation de la production de leur pensée. Jusqu’au sportifs, biberonnés par le système stipendié des clubs de football européens, que l’Africain du continent suit avec enthousiasme les jours de match, depuis le continent noir. Sportifs qui, quand ils viennent à la grand-messe africaine de la CAN « Total Énergies », sous les emblèmes de leurs équipes à nom de fauves (même les Écureuils béninois sont devenus les Guépards, par décret ministériel récent), voient inaugurer leurs agapes footballistiques par un mini-concert d’ouverture du rappeur Booba, le Bounty qui n’a de Sénégalais que le nom et dont le dernier voyage en Afrique doit remonter aux olympiades gréco-romaines.
Mais ce sont les prosateurs d’abord qui sont passés au scalpel d’Elgas, qui fouaille leurs entrailles pour y lire ce qui y est d’Afrique et ce qui est de cet ailleurs qu’on aime tant détester : la France. « L’Afrance », serai-je tenté d’écrire, pour reprendre le cinéaste Alain Gomis, est leur patrie d’adoption, de collusion, d’ambition, où leurs ancêtres sont les Gaulois, pardon, les geôliers, qui laissent les portes de cette prison à ciel ouvert, pas fermées du tout. Le cinéaste Gomis qui fait œuvre d’Afrique mais est plus vu en France que sur le continent noir (tout comme Maty Diop), à part dans les festivals qui sont autant de sépultures de la culture.
« Par essence consubstantielle, la France est l’oppresseur de l’Afrique subsaharienne francophone » : les premiers de ces prosateurs nègres à avoir rué dans ces brancards les emmaillotant portés vers on ne sait où par de bonnes âmes françaises ont connu un destin de météore ou de paria : Yambo Ouologuem, Mongo Beti. Axelle Kabou aussi, pour l’exact contraire : avoir écrit trop tôt que les Africains étaient pas mal responsables de leurs propres maux. Leurs lointains successeurs des années 90 et de la période 2000-2023 ont plus de chance, adoubés par une certaine France – la gauche bobo ?- qui tient là l’occasion de jouir de son besoin de repentance, dose que lui administre les écrivains négropolitains. Calixthe Beyala fait de son crime de plagiat l’emblème du racisme qu’on lui inflige, et continue de vivre à Paris depuis trois décennies, uniquement de ses droits d’auteur plus abondés par des lecteurs français que d’Afrique.
Si le Sénégalais Boubacar Boris Diop répond, fort à propos, dans un collectif d’auteurs de « Négrophobie » au « Négrologie » de Stephen Smith, et qu’il écrit de plus en plus en wolof à l’instar de Ngugi Wa Thiongo, le Kenyan qui rejeta l’anglais, on ne peut s’empêcher de trouver son roman inaugural, « Le cavalier et son ombre », très à cheval dans les clous de ce qu’on attend d’un écrivain africain francophone.
Par peur de passer pour « le nègre de maison », des plumitifs starisés comme l’écrivain-sapeur Alain Mabankou sont finalement revenus de leur rêve de réenchantement de la devise française (Liberté-Égalité-
Une écrivaine trouve grâce aux yeux d’Elgas, pour son parcours littéraire, tout en pas de côté : Léonora Miano. Après des romans crépusculaires et presque victimaires, Miano a commis une dystopie, « Rouge Impératrice », qui renverse le paradigme de l’inégalité des termes de l’échange : un roman dépeignant une Afrique riche désormais assiégée par des Européens pour qui c’est l’Eldorado. Mais, même là, elle n’est pas la première à y avoir pensé, nous fait remarquer espièglement Elgas. L’écrivain, tout ce qu’il y a de Blanc, Pierre Jourde, l’a fait avant elle. Tout de même, Miano a le mérite de voter avec ses pieds et elle prouve le mouvement en marchant : si elle écume toujours les librairies et festivals littéraires de France, la Camerounaise ne s’en est pas moins établie au Togo, à Lomé, depuis quelques années. Le retour à l’Afrique mère de Marcus Garvey est-il la solution ?
Miano et Elgas pourraient tous les deux se retrouver à porter haut le flambeau de cette nouvelle race (pour autant que les races humaines existent…), puisqu’on n’échappe à une assignation que pour tomber dans une autre : la race mutante des Afropéens. A côté des Africains, des Caucasiens, des Asiatiques… Par cette pirouette, on en revient à ce métissage cher à Léopold Sédar Senghor et même, pourquoi pas, à un Cheikh Anta Diop dont on est pourtant moins enclin à penser qu’il puisse avoir eu des faiblesses dans son essentialiste « struggle for black Egypt ». De Léonora Miano, qui fut ma condisciple au lycée de New-Bell à Douala au Cameroun, je peux affirmer qu’elle est née écrivaine : à 16 ans, elle me faisait lire ses manuscrits dans des cahiers à la belle écriture ordonnée. Le jazz coule également dans ses veines : en ces années lycéennes, elle me prêta souvent des disques de vinyle, dont l’un que je fus fort marri d’avoir brisé en deux par négligence, et que je tentai de remplacer par un autre de la même veine du « Rebirth of the Cool ». Miano n’a donc pas échappé à son destin. Destin d’Afropéenne ?
Afropéens, c’est peut-être la voie de l’apaisement et de la médiété, qui manque tant à un Kémi Seba, prompt à brûler en public un billet de Franc CFA, mais avec son passeport français bien au chaud dans sa poche (c’est pratique pour passer les frontières, hein ?). Destins de passe-murailles éternels ou de contrebandiers, alternative qui est celle des intellectuels africains francophones ?
L’essai d’Elgas ne fait pas, non plus, l’impasse sur ces indépendances africaines octroyées (circa 1960 : le péché originel) d’où est née la Françafrique ex-foccartienne, qui continue de tenir les peuples africains subsahariens francophones à bonne distance des lieux de pouvoir économique les plus élevés, le seul important à l’ère où les multinationales sont plus puissantes que les États. Mais tout ayant une fin, serai-je tenté de dire, BNP Paribas se désengage de l’Afrique au moment où le dernier discours du Président Macron appelle les entreprises françaises à aller batailler pour plus de parts de marchés en Afrique, désormais trustées par la Chine et autre pays émergents qui lui taillent des croupières.
L’historienne et journaliste franco-tunisienne juive (ça en fait, des identités !) Sophie Bessis, qui préface, avec une plume au laser, cet essai d’Elgas est en terrain connu. Ex-rédactrice en chef du magazine hebdo-parigot « Jeune Afrique » (autre antre du diable pour les décoloniaux, qui ne peuvent pourtant pas s’empêcher de bicher quand ils figurent dans ces pages), elle a surtout commis successivement, et dans une belle constance, ces titres évocateurs : La Dernière frontière : les tiers-mondes et la tentation de l’Occident, (Paris, Jean-Claude Lattès, 1983, 298 p.), L’Occident et les Autres : histoire d’une suprématie, (Paris, La Découverte, 2003, 350 p.), « La Double impasse : l’universel à l’épreuve des fondamentalismes religieux et marchand, Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2014, 240 p.).
Chercheuse associée à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) de Paris, Sophie Bessis est en parenté d’esprit et de complicité avec Elgas : à désormais 76 ans, elle semble lui transmettre le bâton de maréchal de la (re)conquête de l’illustration et de la défense de l’identité afropéenne.
L’album du Sénégalais Wasis Diop, « De la glace dans la gazelle », dont les paroles sont uniquement en français (une première !), vient de s’achever de tourner, dans la nuit dakaroise où j’écris cette note de lecture. Restons-en donc là : la messe est dite, mais les yeux de Chimène de Paris valent bien une sarabande de messes africaines.
Ousseynou Nar Gueye
Éditorialiste
Fondateur du site d’information Tract.sn





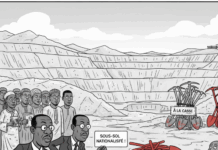

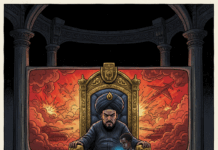

![[Éditorial] ‘Affaire Softcare’, la page tournée : la victoire de la transparence et du ‘Made in Senegal’ (Par Bassirou Niang, journaliste)](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/03/SOftcare-epilogue-transparence-218x150.png)
![[Bouli..Mimi..que] Coalition du PR : Mimi Touré déploie les tentacules, PR Diomaye rabaisse le rideau sur le Pastef ‘mimifié’ (Par Ousseynou Nar Gueye)](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/03/Ousseynou-Nar-Gueye-veste-jean-cravate-grise-gros-plan-218x150.jpg)
![[LE BIAIS DE NÉNÉ SOW] Humilité, lucidité et une pincée du piment ‘Mimi Touré’ : les ingrédients de Diomaye, concepts non-enseignés dans les écoles du Pastef](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/03/Diomaye-cuisinier-et-Sonko-fache-218x150.png)

