« Les Epouvantails » (96 mn ; 2019) de Nouri Bouzid, projeté en film d’ouverture des JCC 2019, le 26 octobre, explore la souffrance de deux femmes sauvées des affres de la guerre et du viol en Syrie. Mais des obstacles se dressent face à la mémoire en l’empêchant de se dévoiler quand ce n’est pas la caméra qui tout bonnement se cherche une cécité…
On en regretterait amèrement le manque d’audace du réalisateur qui a esquivé le sens de la profondeur sur une question qui socialement, religieusement et cinématographiquement divise, fracture plus qu’elle n’en apaise les consciences. « Les Epouvantails » tirent des tiroirs un silence pesant, des cicatrices, de la violence sexuelle ‘’légitimisée’’ par des gens décalés de l’humain. Mais la caméra n’a pas eu la largeur visuelle qui aurait pu donner au film ce langage plaisant, dépouillé de cette sensation de suivisme qui fait se ressembler beaucoup de films traitant du même thème.
Cette caméra traque l’intimité du récit, scrute comme une loupe les visages pour mieux saisir le sens des mots sortis de la bouche de Zina ou quand elle cherche à rendre audible le silence peinant de Djo, autre rescapée à qui la violence du « jihadisme sexuel » a arraché à jamais la parole pour n’admettre chez elle que l’usage de l’écriture. Les plans rapprochés dominent l’activité de filmage, avec parfois des mouvements circulaires rendant compte sans doute de la confusion des sentiments, du refus de se souvenir pour ne pas davantage souffrir et faire souffrir. Le récit prend des allures de saccades tout en faisant l’impasse sur de possibles scènes non filmées qui en faciliteraient sans nulle doute l’accès à u meilleure compréhension de l’état psychologique des personnages.
Dans ce film, le mur est un personnage autre : il est le télégraphe d’un déclin existentiel chez Djo, celle qui tient un journal sur ce bloc de béton et sur des feuilles pour donner les tableaux sinistres d’un monde cruel capable de ramener à une sorte de néant un être. « Je n’étais plus qu’une carcasse », a-t-elle écrit. Chez Zina, l’intolérance d’un père et d’une société, l’impuissance d’une avocate, Nadia, alourdissent la peine tout en montrant les fractures d’une société. L’errance de ce personnage, ses visages changeants se lisent dans les transitions symbolisées par l’incinération de ses habits noirs, l’abandon momentané du voile, sans oublier l’enlacement joyeux au milieu d’un drap blanc surprenant avec un homosexuel qui a tant voulu partager sa peine. Une renaissance, ça y ressemble fort, sauf que la scène offre une fausse illusion référentielle. Le destin de Zina bifurquera sous la menace d’un père qui vit dans la haine de sa fille et aurait préféré la savoir morte que vivante.
« Il manquait un voyage à mon corps », dira-t-elle dans ses premiers instants de confidence à sa mère, Saïda, qui fait des épouvantails dans son atelier. Ces derniers portent toute la charge du rejet de l’humanité des deux personnages meurtris.
Ce corps chez Zina qui a perdu une partie d’elle-même dans cette territorialité où le viol est « Halal » : un enfant ! « Halal », mot d’une glaceur épouvantable quand Zina, égarée malgré elle dans les prairies jihadistes, se raconte au retour de l’enfer après un temps assez court de folie. Elle se raconte en ‘’lisant’’, pour ainsi dire, « les traces sur son corps ».
Mais sur les traces de « Les Epouvantails », la mémoire de la douleur a plus à raconter qu’elle n’en montre avec ‘’sa’’ caméra.
Bassirou NIANG
In www.africine.org



![[LE BIAIS DE NÉNÉ SOW] Humilité, lucidité et une pincée du piment ‘Mimi Touré’ : les ingrédients de Diomaye, concepts non-enseignés dans les écoles du Pastef](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/03/Diomaye-cuisinier-et-Sonko-fache-218x150.png)
![[Très NRV] ‘Je dénonce la cherté du pagne officiel du 8 mars 2026 au Cameroun’ (Adeline Tsopgni, leader estudiantine)](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/03/Chantal-Biya-Defile-8-mars-2026-218x150.webp)

![[L’ET DIT TÔT D’O.N.G] 1er Sommet Afrique -France anglophone à Naïrobi : voici pourquoi ‘l’AFrance’ ne ‘garantira’ plus le Franc CFA en 2027 (Par Ousseynou Nar Gueye)](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260303-WA0003-218x150.jpg)
![[L’ET DIT TÔT HEBDO] Lois anti-homosexualité bientôt ‘durcies’ : le gouvernement Sonko 2 se trompe de cible et de siècle](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/02/Capture-decran-2026-02-27-165238-218x150.png)
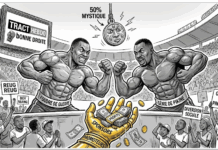
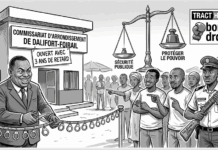
![[Triomphe de l’économie informelle] Kaolack en sueur, entre Ramadan, Koor, Carême et chaleur de 42 degrés à l’ombre](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/02/Capture-decran-2026-02-27-162111-218x150.png)

![[L’ET DIT TÔT D’O.N.G] COMDAMNER ‘L’APOLOGIE’ DE L’HOMOSEXUALITÉ ? LA LIBERTÉ D’EXPRESSION SACRIFIÉE SUR L’AUTEL DU POPULISME (Par Ousseynou Nar Gueye)](https://tract.sn/wp-content/uploads/2026/03/Ousseynou-Nar-Gueye-en-costume-marron-et-chemise-noire-12-mars-2026-324x160.jpg)
